Replay du webinaire du 12.06.25
Les deux premiers intervenants, Ez-Zoubir AMRI et Isabelle DUGAIL, présenteront le contexte avec des exemples issus de la bibliographie, mais aussi leurs expériences de l’impact de la température à laquelle les souris sont maintenues sur les constantes physiologiques, l’expression de phénotypes ou sur le métabolisme. Pour conclure, Chrystophe Ferreira, abordera l’aspect réglementaire pour comprendre comment intégrer cette dimension dans un cadre de recherche. La température fait partie des nombreux facteurs externes, comme l’hygrométrie, l’alimentation, le nombre d’animaux par cage, voire l’enrichissement, qui peuvent influencer les résultats expérimentaux et expliquer des différences entre études, localement ou entre laboratoires. Ces informations sur les facteurs environnementaux parfois difficiles à contrôler sont mesurables, devraient faire partie intégrante des métadonnées et de la description du protocole de chaque étude sur l’animal pour une meilleure reproductibilité ou compréhension des différences.
Les modèles animaux demeurent une nécessité pour l’étude des maladies humaines complexes. La souris est le modèle le plus utilisé, et comme les êtres humains, un mammifère endotherme maintenu à environ 22 °C dans les animaleries. A cette température, son métabolisme énergétique est suractivé, une situation rarement observée chez les êtres humains grâce à diverses adaptations (vêtements, chauffage, etc.). La zone de thermoneutralité est définie comme une plage de températures ambiantes qui permet à un organisme de réguler sa température corporelle sans recourir à des processus de thermorégulation supplémentaires. Il existe de nombreux exemples de résultats divergents entre des études menées à 22 °C et celles réalisées à 30 °C (thermoneutralité chez la souris). De nombreux exemples seront présentés, montrant qu’il est essentiel de prendre en compte la température d’hébergement tant pour le bien-être animal que pour la pertinence des résultats des expériences réalisées.
Les modèles murins de maladies métaboliques sont très utilisés malgré les différences physiologiques avec l'homme. A partir d'exemples, nous abordons l'importance des études en thermoneutralité pour la validation de cibles d'intérêt pour les maladies humaines à partir de ces modèles. De plus, l'Impact des conditions climatiques (température) sur le microbiote intestinal est évoqué à partir des données récentes de la littérature.
L’utilisation de modèles animaux à des fins scientifiques est strictement règlementée et est régie par différents textes légaux et dispositifs éthiques. Les principaux points de ce cadre règlementaire en lien avec les consignes de température dans les établissements utilisateurs seront rappelés. L’importance du dialogue avec les différents acteurs des autorisations de projets dans un cadre éthique (SBEA, C2EA, responsable d’animalerie et Copil) sera soulignée pour le maintien de résultats scientifiques de qualité. Les aspects pratiques de préparation et de réalisation des procédures dans cette perspective seront également abordés.

Ez-Zoubir AMRI
DR CNRS
Directeur de Recherche au CNRS, M. Ez-Zoubir AMRI est responsable de l’équipe ‘’Régulation cellulaire et moléculaire de la masse grasse’’ à l’Institut de Biologie de Valrose de Nice. Ses intérêts scientifiques visent à décrypter les mécanismes de formation et d’activation des adipocytes « brite », le contrôle nutritionnel du brunissement des adipocytes blancs et le rôle de l'ocytocine dans la prévention de l'obésité, l'ostéoporose et l’ostéoarthrose. Ses travaux ont permis de caractériser le processus de la conversion des adipocytes blancs en adipocytes bruns/brites et identifié plusieurs composants clés contrôlant cette étape, tels que certains micro-ARN ou encore des lipokines.

Isabelle DUGAIL
DR Inserm
Isabelle Dugail est Directrice de Recherche à l’Inserm au sein de l’unité NutriOmics (UMR 1269, Sorbonne Université/Inserm), à la Faculté de Santé Pitié-Salpêtrière. Elle y coordonne l’axe scientifique « Remodelage du tissu adipeux ». Ses travaux portent sur la physiopathologie du tissu adipeux dans l’obésité. Elle combine modèles murins, approches in vitro et analyses lipidomiques à haut débit pour étudier les dysfonctions du tissu adipeux liées aux variations métaboliques (prise ou perte de poids) et phénotyper les patients obèses. Elle a notamment mis en évidence des liens fonctionnels entre l’homéostasie du cholestérol et le stockage lipidique dans l’adipocyte.

Chrystophe FERREIRA
IRHC-Université Paris Cité - Pôle ANIMA 75
Docteur en embryologie, Chrystophe Ferreira a débuté sa carrière comme responsable de plateau technique dédié à la création de modèles murins génétiquement modifiés, puis comme responsable d’animaleries les hébergeant. Il est maintenant à l’Université Paris Cité en tant qu’ingénieur de recherche, où il codirige avec Isabelle Le Parco, la coordination de l’expérimentation animale au sein du pôle ANIMA 75, qu’il représente auprès de plusieurs partenaires institutionnels. Son parcours lui a permis d’acquérir une expertise large de l’expérimentation animale, incluant l’animation de SBEA, la participation à des comités d’éthique, ainsi qu’un engagement actif dans plusieurs sociétés savantes et associations professionnelles liées à ce domaine d’activité.
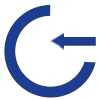 Retour
Retour